Comment apprendre à reconnaître facilement et rapidement les plantes et les animaux autour de chez soi ?
Il y a quelques années, alors que je postulais à des postes de chargé d’étude biodiversité, je n’ai pas trop eu le choix : il fallait des connaissances naturalistes sur de nombreux groupes d’espèces.
Je m’y connaissais bien en oiseaux, mais il fallait que j’acquière des connaissances sur les libellules, les papillons, les plantes, les amphibiens … et rapidement.
Ça s’annonçait donc plutôt compliqué.
Pas le choix, il fallait trouver des solutions. J’ai donc adopté une stratégie pour apprendre rapidement à reconnaître les espèces les plus communes de chaque groupe d’animaux et de plantes.
En France métropolitaine, on retrouve environ 10 000 espèces de plantes, 570 espèces d’oiseaux ou encore 250 espèces de papillons de jour, …
Autant dire que sans stratégie, apprendre à identifier la faune et la flore semble plutôt compliquée.
Dans cet article, nous allons donc voir comment apprendre à reconnaître facilement les espèces que l’on peut rencontrer juste à côté de chez soi avec cette stratégie.
Chaque balade peut être l’occasion de nouvelles découvertes et rencontres dans un milieu qui aura alors l’air bien plus vivant et diversifié. Reconnaître les plantes et les animaux, c’est se rendre compte que notre environnement est fait de nombreuses espèces différentes, qui interagissent et cohabitent !
Prêt à explorer tout ça ensemble ? C’est parti ! 🙂
Pourquoi apprendre à reconnaître les animaux et les plantes
Reconnaître les espèces vivantes qui nous entourent est un vrai plaisir.
Il y a ce sentiment de ne plus se promener dans un décor, mais dans un environnement vivant, complexe, avec des espèces qui vivent, cohabitent et interagissent entre elles.
C’est une première entrée possible pour commencer à s’intéresser à la nature.
Savoir nommer, c’est aussi pouvoir participer activement à la connaissance et donc à la protection de ces espèces.
La connaissance est essentielle pour avoir des indicateurs sur l’état de santé des espèces vivantes et ce sont ces indicateurs qui permettent d’argumenter pour la mise en place de politiques de préservation.
Une partie importante de ces indicateurs reposent justement sur des données d’amateurs passionnés (c’est le principe des sciences participatives).
C’est par exemple le cas du protocole de suivi temporelle des oiseaux communs (le « STOC« ), qui fournit des données précieuses depuis plus de 30 ans sur l’état des populations d’oiseaux.
Il y a tout de même une petite chose à garder en tête : il ne s’agit pas de nommer pour nommer.
Le piège serait de se dire, « je connais le nom de cette espèce donc je sais tout sur elle ».
En fait, ce n’est qu’une toute petite partie que l’on connaît quand on a appris un nom.
Un nom ne doit pas être une étiquette qui amène à faire des généralités et fait que l’on est moins curieux : une espèce c’est aussi un mode de vie, un habitat, des comportements, des stratégies de communication et de survie …
Au sein d’une même espèce, comme chez nous, il y a des individus qui sont tous différents, avec leurs caractères propres et même leur personnalité (ce qui a par exemple été étudié chez les poissons ou les mammifères).
Nommer n’est également pas du tout nécessaire pour commencer à s’intéresser à la nature et découvrir des choses.
C’est vraiment quelque chose à garder en tête pour ne pas tomber dans ce piège et rester curieux. Le Nature journaling est d’ailleurs un bon moyen de garder et développer cette curiosité.
Bon, c’est pas tout, mais comment faire concrètement pour apprendre à identifier les plantes et les animaux ?
Voyons ça tout de suite 🙂

Le Paon-du-jour, un papillon magnfique que l’on peut rencontrer
un peu partout (Kie-ker, Pixabay)
Comment apprendre à reconnaître rapidement les principales espèces autour de chez soi étape par étape
Avant de commencer, un petit mot s’impose sur les applications de reconnaissance automatique.
Ici, je vous propose une approche pour apprendre à reconnaître les espèces en autonomie.
Les applications peuvent être d’une grande aide (pour en savoir plus, rendez-vous sur cet article) mais si vous vous arrêtez là, vous serez à 100% dépendant de votre téléphone et ce n’est pas vraiment l’idée ici.
Je reviendrais rapidement sur quelques applications qui peuvent être bien utiles à la fin de la prochaine partie de cet article.
Voyons donc comment faire avec la première étape.
1. Choisir un groupe d’espèce
Quand on aime la nature, c’est très tentant de vouloir tout reconnaître et s’intéresser à tout en même temps.
Le risque est de s’éparpiller et au final, de ne pas réussir à reconnaître grand chose.
Le mieux pour progresser rapidement est donc de choisir un groupe d’espèces (oiseaux, plantes, libellules, …) par lequel commencer et de se concentrer dessus avant de passer à un autre groupe.
Le plus important est que ce groupe d’espèces vous intéresse.
Ensuite, un autre point à regarder est si vous avez des chances de rencontrer ces animaux ou plantes facilement au quotidien et s’il y a beaucoup d’espèces dans ce groupe.
Pour les libellules et les amphibiens, vous aurez par exemple assez vite fait le tour et vous pourriez être capable de reconnaître rapidement la plupart des individus que vous rencontrerez le plus souvent sur le terrain (ce qui peut être une source de motivation).




Oiseaux, plantes, grenouilles … la première chose va être de choisir par où commencer
2. Identifier les espèces que l’on a le plus de chance de rencontrer
Une approche pratique pour bien mémoriser
L’idée est de se concentrer sur les espèces que vous avez le plus de chance de rencontrer sur le terrain.
C’est en quelque sorte une stratégie « 20/80 » : on choisir de se concentrer sur les 20% d’espèces que vous rencontrerez dans 80% des situations.
Cette approche est vraiment la plus efficace pour progresser vite et bien mémoriser.
La mémoire repose sur plusieurs choses dont 2 piliers qui vont particulièrement nous intéresser ici : la répétition et la motivation.
Pour la répétition, l’idée est qu’une information, pour être retenue à long terme, doit être réutilisée.
A chaque fois que vous rencontrerez une espèce en extérieur que vous aurez appris à reconnaître, cela constituera un rappel qui fera que vous consoliderez encore un peu mieux cette nouvelle connaissance.
Pour la motivation, on retient beaucoup mieux quelque chose qui nous motive.
Apprendre à reconnaître une espèce que vous pouvez rencontrer à deux pas de chez vous sera sans doute plus motivant et concret que d’apprendre à reconnaître une espèce extrêmement rare que vous aurez très peu de chance de rencontrer.
Et oui, l’idée est quand même de savoir identifier des animaux et des plantes que vous verrez au cours d’une balade, si vous ne rencontrez jamais ces espèces, ça n’a pas beaucoup d’intérêt.
Une fois les espèces les plus communes apprises, dès que vous rencontrerez une espèce que vous ne connaissez pas, vous pourrez par exemple la prendre en photo, ou utiliser une application pour connaître son nom, puis faire la démarche que nous allons voir pour apprendre à la reconnaître.
Vous aurez donc une base solide et pourrez progresser petit à petit ensuite.
Pas mal non ? 😉
Trouver les espèces que l’on a le plus de chance de rencontrer
La méthode rapide : utiliser l’IA pour une approche 20/80
L’approche la plus simple et la plus directe pour connaître les principales espèces que l’on peut rencontrer est d’utiliser l’IA.
Vous pouvez par exemple poser la questions suivantes à ChatGPT :
« Quelles sont les 20% d’espèces de [nom du groupe] que l’on a 80% de chance de rencontrer en balade en [nom de la région] ? »
Attention à être précis sur le nom du groupe, il y a parfois certains pièges.
Pour les libellules, utilisez bien le nom exact « odonates », qui concerne à la fois les libellules et les demoiselles. Idem pour les papillons, si vous vous intéressez uniquement aux papillons de jours, précisez-le bien ou utilisez le terme plus scientifique « rhopalocères ».
Cette approche fonctionne plutôt bien mais à quand même quelques limites.
Par exemple, pour les groupes qui comprennent beaucoup d’espèces comme les oiseaux, de nombreuses espèces communes n’apparaîtront pas si vous vous limitez à seulement 20% des espèces que l’on peut rencontrer dans votre région.
Se concentrer sur les espèces les plus communes
Une autre possibilité, qui va demander un peu plus de recherches, est de vous concentrer sur les espèces les plus communes.
Pour les trouver, deux indicateurs peuvent vous aider :
- Le statut de rareté, le mieux mais il n’est pas toujours accessible
- Le statut de menace, qui permet d’avoir une idée de la rareté d’une espèce.
La rareté est ce qui nous intéresse le plus puisqu’elle correspond directement à la surface qu’occupe une espèce sur un territoire.
Pour la trouver, voici quelques pistes :
- Les « listes rouges » régionales, qui indiquent le niveau de menace qui pèse sur une espèce, indiquent parfois leur caractère plus ou moins commun. Ces listes ont l’avantage d’être nombreuses, d’exister pour toutes les régions et pour un grand nombre de groupes d’espèces. Pour les trouver, cherchez simplement « liste rouge [groupe d’espèce] de [nom de la région] »
- Les bases de données naturalistes régionales indiquent parfois le statut de rareté et permettent de chercher directement les espèces les plus communes observées. Elles peuvent être gérées par des structures publiques ou des associations. Pour les trouver, vous pouvez rechercher « base de données naturaliste [nom de votre région] ».
Pour les bases de données, une très utilisée est celle de la LPO, « Faune-France ».
Pour choisir les observations par groupe d’espèces, il faudra se rendre sur sa déclinaison régionale.
Pour la trouver, cherchez simplement « Faune-[nom de votre région] ».
En créant un compte (qui sera commun pour la base de donnée nationale « Faune-France » et pour chaque base de donnée régionale) vous pourrez accéder aux observations récentes en choisissant le groupe d’espèces qui vous intéresse et le statut de rareté (dans l’onglet « Consulter »).
Vous pourrez alors obtenir rapidement une liste des espèces les plus communes pour le groupe qui vous intéresse.
L’autre approche est de se concentrer sur les espèces les moins menacées référencées dans les listes rouges.
Le statut de menace n’est pas l’équivalent de la rareté mais il peut vous donner une bonne idée puisque assez souvent les espèces les plus rares sont aussi les plus menacées.
Pour ça, cherchez la liste rouge qui vous intéresse (« liste rouge [nom de votre région] de [nom du groupe d’espèces] ») puis sélectionnez les espèces « LC » pour « Low-concern » / Non menacée.
Ces deux dernières approches, sélectionner par statut de rareté ou par statut de menace, fera que les listes seront un peu plus longues qu’avec l’approche 20/80 via ChatGPT mais aussi plus complètes.

2ème étape : se pencher sur les espècesà apprendre
à identifier (Jade87, Pixabay)
3. Apprendre à déterminer ces espèces
Une fois le groupe d’espèce choisi (les oiseaux, les mammifères, les papillons, etc), vous allez vous retrouver avec plus ou moins d’espèces.
Si vous faites une observation, ça peut donc être compliqué de trouver précisément quelle espèce vous avez vu. Par exemple pour les papillons, si vous devez chercher parmi les 250 espèces qui existent laquelle vous avez observée, ça peut être un peu long …
Pour nous aider, nous allons donc procéder par étape.
En fait, les espèces peuvent être regroupées en famille, en fonction de certaines ressemblances qu’elles ont entre elles.
Si vous faites une observation, et que vous êtes capable de dire que l’individu que vous avez vu appartient à telle famille et tel groupe de papillons, vous allez vous retrouver à chercher parmi un nombre très restreint d’espèces, peut-être une petite dizaine, et l’identification sera beaucoup plus facile.
On pourrait prendre l’image d’un meuble.
Le meuble représente le grand groupe d’espèces (les oiseaux, les papillons, etc). Dans ce meuble, il y a différents tiroirs. Chaque tiroir correspond à une famille d’espèces. Dans ces tiroirs, il y a parfois des compartiments séparés qui correspondent à des sous-groupes.
Enfin, on retrouve les espèces qui sont rangées dans ces compartiments.
Avant de ranger nos espèces dans le meuble, il va donc falloir ajouter le tiroir et éventuellement le bon compartiment à l’intérieur.
Pour ça il va s’agir de connaître les critères de la famille (= le tiroir) correspondant à notre espèce et éventuellement les critères du sous-groupe (= le compartiment à l’intérieur du tiroir).
Un exemple concret : les papillons
Voici un petit exemple pour que ce soit plus concret.
Si je veux apprendre à reconnaître les principales espèces de papillons de jours, voici la démarche que j’adopterais, que vous pouvez bien-sûr adopter pour n’importe quel groupe d’espèces.
Je me rendrai sur la base de donnée régionale qui me permet d’avoir des informations sur le caractère plus ou moins commun des espèces dans ma région, ici « Faune-Normandie ».
Bon, la saison n’est pas idéale en ce moment, il n’y a donc pas beaucoup d’observations récentes.
Je vais donc soit demander à ChatGPT pour avoir les 20% d’espèces les plus communes, soit me rendre sur la liste rouge régionale pour avoir quelque chose de plus complet.
Partons sur la deuxième option.
Une fois sur la liste (choisi au format tableau pour une sélection plus facile), le statut de rareté n’est pas indiqué, je sélectionne donc les espèces les moins menacées (« LC »). Je me retrouve donc avec 63 espèces au lieu des 112 présentes dans la région. En testant l’option ChatGPT, j’obtiens 20 espèces.
Je choisi ensuite une espèce parmi les 63, mettons le « Paon-du-jour ».
Ensuite, le plus facile est de choisir un guide de référence qui comprend des clés d’identification.
Pour les papillons, la référence est le « Guide des papillons de France », de Tristan Lafranchis (disponible gratuitement ici).
Dans ce guide, je file donc directement à l’index pour retrouver la page qui correspond à mon espèce.
Je note ensuite dans quel groupe d’espèces mon Paon-du-jour se retrouve. Il se retrouve dans la famille des « Nymphalidae » puis dans le groupe des « Vanesses ».
L’idée va donc ici être de construire mon meuble et de placer les tiroirs : je me réfère au guide pour connaître les critères communs aux Nymphalidae (premier tiroir) puis au Vanesses (compartiment dans ce tiroir).
Voici ce qui ressort :
- Nymphalidae : le papillon a les antennes rapprochées et seulement 2 paires de pattes sont visibles.
- Vanesses : les ailes sont anguleuses.
Ce sont ces critères que je vais chercher à retenir. Dans un 2ème temps j’apprendrais les critères plus spécifiques de l’espèce (les 4 grands cercles colorés, les « ocelles », sur les ailes par exemple).
Dans le groupe des Vanesses il n’y a plus que 9 espèces assez faciles à distinguer avec une photo.
Si je recroise une espèce de papillon qui ressemble au Paon-du-jour et que je connais les critères que l’on vient de voir, je pourrais directement savoir qu’elle appartient au groupe des Vanesses et je n’aurais plus qu’à chercher parmi les 9 possibilités qui existent.
En résumé, une fois l’espèce choisie je vais chercher à retenir :
- les critères de sa famille
- les critères de son groupe
- les critères de l’espèce
Ça peut paraître un peu fastidieux mais c’est vraiment la manière la plus rapide et efficace d’apprendre rapidement à identifier les espèces les plus communes. Les critères de famille ne seront à apprendre qu’une seule fois et il n’y a qu’un nombre assez faible de famille à chaque fois (6 pour les papillons de jours par exemple).
Voici quelques exemples de guides bien faits avec des clés de détermination.
Ce genre de guide est vraiment idéal mais vous pouvez très bien vous en sortir avec des recherches internet.
- Le Guide des papillons de France, Tristan Lafranchis
- Le Cahier d’identification des libellules de France, Belgique, Luxembourg et Suisses, de Jean-Pierre Boudot, Guillaume Doucet, et al.
- Le Guide Delachaux des fleurs de France et d’Europe, de David Streeter, et al.



Quelques guides de référence avec des clés d’identification
Conclusion
Et voilà pour cette première partie assez dense déjà. Nous avons vu la démarche principale pour apprendre à reconnaître les espèces les plus communes que l’on peut rencontrer autour de chez soi.
Une fois le groupe d’espèce choisi, il s’agit donc d’identifier les espèces qui sont les plus communes en utilisant les statuts disponibles (rareté ou menace) via des bases de données régionales ou des « listes rouges », ou bien d’utiliser l’IA pour avoir une liste restreinte d’espèces communes dans votre région.
Ensuite, nous avons vu comment apprendre à reconnaître rapidement ces espèces, avec une démarche pas à pas : identifier la famille de l’espèce, puis son groupe et regarder les critères correspondant. Ce sont ces critères que l’on va chercher à retenir.
Comme l’idée est de se concentrer uniquement sur les espèces les plus communes, le tout est assez rapide.
Bon par contre, même si ça réduit beaucoup le nombre d’informations à retenir, puisqu’il ne faudra apprendre les critères de famille qu’une fois, ça fait quand même pas mal de choses à mémoriser. Le côté facile n’est donc pas si évident pour l’instant.
Comment retenir tout ça facilement et efficacement sans s’arracher les cheveux ? La réponse repose sur quelques astuces de mémorisation.
C’est ce que nous allons voir dans la prochaine partie dans laquelle nous verrons comment retenir toutes ces informations à long terme – même les noms un peu bizarres qui ne nous disent pas grand chose (comme « Nymphalidae » 😉) -.
Nous verrons aussi comment utiliser les applications au mieux pour vraiment apprendre à reconnaître les plantes et les animaux.
Pour retrouver cette deuxième partie, ça se passe juste ici.
A très vite !
Vous avez aimé cet article ?
Recevez gratuitement en complément
le guide « 5 Clés pour découvrir la nature grâce au dessin«
A l’intérieur vous y trouverez :
- 3 étapes pour capturer et retenir vos découvertes nature
- Comment utiliser vos 5 sens pour découvrir les merveilles de la nature et enrichir vos dessins
- Quel matériel choisir pour démarrer le dessin et l’observation de la nature
- Comment exprimer votre créativité et explorer différentes techniques de dessin


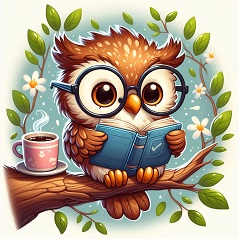
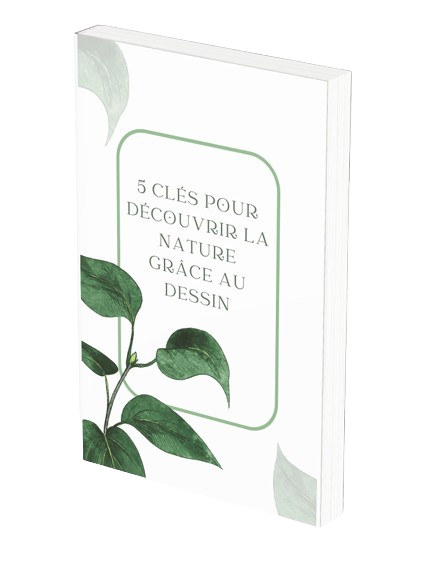
Merci Florian pour cet article très intéressant ! J’ai appris pleins de choses 🙂 Je ne connaissais pas du tout ces techniques pour apprendre à reconnaitre les espèces que je croise régulièrement lors de mes balades dans la nature. J’aime beaucoup la façon dont tu expliques la méthode avec l’analogie du meuble et des tiroirs. Merci pour le partage !
Merci beaucoup pour ton retour Alice ! Content que cet article t’ai plu et t’ai donné des astuces pour reconnaître les espèces ! 🙂